ANNEXE I: Les MIOM sont-ils inertes et sans danger?
ANNEXE II: Les effets des métaux lourds sur la santé.
La nature des MIOM, leur caractérisation et leur potentiel polluant. Première remarque, les précautions imposées par la circulaire ministérielle 94-IV-1 du 9 mai 1994, relative à l‘utilisation des MIOM déclarés Valorisables, démontre à elles seules la dangerosité potentielle officiellement reconnue de ces matériaux:
- Ils ne sont stockables qu’en installation de stockage permanent de déchets ménagers et assimilés (installations de classe II) (obéissant à des règles strictes de précautions d‘isolement par rapport au milieu extérieur);
- Valorisés, ils ne doivent être placés qu‘à plus de 30m de cours d‘eau, hors zone inondable, etc…-
- En sous-couche routière ou en talus, leur épaisseur ne peut dépasser 3 mètres;
Nous nous réfèrerons principalement et volontairement à deux documents établis sur des bases strictement scientifiques publiés par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (Damien, 1997, et Piantone et al, 2000). On ne peut donc pas les accuser de catastrophisme, et pourtant… les conclusions (toujours valables en 2004) s’imposent d’elles même et sont sans appel.
La composition des MIOM:
« Les compositions chimiques des mâchefers issus d‘ordures ménagères en sortie de l‘incinérateur varient fortement dans le temps et dans l‘espace » (Damien, 1997, p.10/22) car elles sont dépendantes de la composition (très variable) des ordures incinérées.
Les composants qui doivent retenir notre attention dans le cadre de ce projet sont surtout les métaux lourds. Ceux-ci sont reconnus depuis longtemps comme dangereux pour la santé, si bien que leur teneur dans les produits de lixiviations (voir ci-dessous) servent à leur classement en catégories V, M eu S (Circulaire du 9 mai 1994). Ce sont, pour les plus importants: le plomb, le cadmium, le mercure et l‘arsenic.
Selon la répartition et la nature des ordures ménagères, les mâchefers ont des compositions en métaux lourds extrêmement variables (Exemple: 2 mesures de teneur en plomb sur des mâchefers issus de la même usine d’incinération mais prélevés à un jour d’intervalle : les teneurs varient de 1 à 6 g de plomb par kilo de mâchefer (Damien, 1997: annexe 9, p.5).
Outre des imbrûlés organiques, les mâchefers contiennent certains composés dont la toxicité est reconnue: les PCDD (Polychlorodibenzo-p-dioxines), les PCDF (Polychlorodibenzo-p-furanes), les CB (Chlorobenzènes), les CP (Chlorophénols), les PCB (Polychlorodyphényls) et les HAP (Hydrocarbures polycycliques Aromatiques) (Piantone et al, 2000, p.29).
Le point important, comme on le verra plus loin, est que les métaux lourds sont sous forme de composés chimiques (minéraux formés pendant l‘incinération) extrêmement variables. Par exemple, le plomb peut exister sous forme de plomb métal (Pb), d‘oxyde (PbO), de silicates divers (Pb 2SiO 4, …), de chlorure (PbCl), de phosphate, d‘alliages divers, et même chose pour les autres métaux lourds (Piantone et al, 2000, p.42-43). La diversité de ces produits est due à l‘hétérogénéité des ordures ménagères et à la température, parfois fortement variable d‘un point à un autre, pendant l‘incinération.
La conclusion de ceci est que si l’on veut soigneusement contrôler les teneurs en métaux lourds des mâchefers, il faudrait effectuer des analyses chimiques de manière très fréquente, ce qui n’est jamais pratiqué dans le cas des mâchefers (voir ci-dessous)., et d’ailleurs pratiquement impossible financièrement.
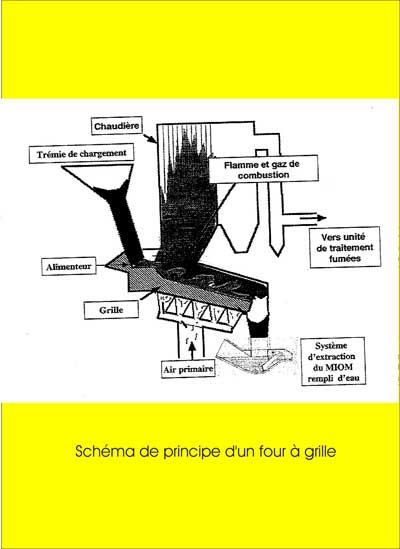
Le suivi de la composition des MIOM est-il suffisant et fiable ?
En sortie de l’incinérateur de l’Ariane (Nice), des tests de lixiviation sont effectués à la fréquence de 1 par mois. L’industriel dit procéder à des mesures complémentaires par prélèvements sur site.
Il faut savoir qu‘effectivement, les seuls contrôles effectués (destinés à les classer dans les catégories V, M ou S) sur les mâchefers sont leur taux d’imbrûlés et leur taux de lixiviation. Il n’y a pas d‘analyse chimique directe et donc pas de contrôle direct de la teneur en métaux lourds! Les tests de lixiviation sont définis dans la circulaire DDPR/SEI/BPSIED ° 94-IV du 9 mai 1994, ils consistent en 3 lixiviations successives, selon le protocole d’analyse X32-210, qui est sensé donner une évaluation de leur potentiel polluant (attention: ceci n’est pas une analyse chimique du mâchefer, il s’agit de l’analyse d’une solution ayant traversé le mâchefer).
Deux remarques importantes doivent être faites ici:
Remarque (1). Les tests de lixiviation ne sont pas suffisamment représentatifs de la teneur en métaux lourds: illustrons ceci par la comparaison de 2 machefers (a et b) issus de 2 usines différentes (Damien, 1997: annexe 5, p. 5 et 11; annexe 7, p.5 et 11). Le mâchefer (a) est déclaré valorisable (V), et le test de lixiviation a fourni 4,8 mg/kg de plomb (Pb), largement au dessous de la limite de 10 mg/kg pour être déclaré Valorisable. Le mâchefer (b) est déclaré maturable (M), et le test de lixiviation a fourni plus de 2 fois plus de Pb (soit 10,9 mg/kg).
Néanmoins, les 2 mâchefers ont des teneurs en Pb pratiquement équivalentes, de 1,4 (a) et 1,5 (b) g/kg: l‘un est Valorisable, l‘autre non! Voici pourquoi ci-dessous.
Remarque (2). Les tests de lixiviation n’ont de valeur qu’à l’instant de l’analyse.
En effet, certains métaux lourds peuvent appartenir à des phases minérales parfaitement résistantes à la mise en solution au moment du test. En revanche, le MIOM étant très instable au cours du temps, ces mêmes métaux lourds peuvent se retrouver après plusieurs années dans d’autres phases minérales beaucoup plus vulnérables à l’action de l’eau. Citons le rapport de Piantone et al (2000, p. 104): „Pour un matériau très réactif comme les MIOM, l‘utilisation d‘un essai de lixiviation n‘aura aucune valeur prédictive: le paramètre mesuré ne rendra compte que de l‘état physico-chimique du MIOM au moment de la mesure“.Remarquons en passant qu‘on ne peut être plus clair sur le caractère non inerte des MIOM!
Enfin, les tests de lixiviation sont effectués à une fréquence bien trop faible pour être représentatifs. Le cahier des charges de l‘incinérateur de l‘Ariane (Arrêté Préfectoral des Alpes Maritimes numéro 11273 du 9 avril 1996 (p.12)) impose un test de lixiviation par trimestre, ce qui est dérisoire, compte tenu de la forte variabilité dans le temps de la teneur en métaux lourds dans les mâchefers (mais actuellement, un test par mois est efectué).
En conséquence, les MIOM déclarés Valorisables par les tests de lixiviation peuvent être porteurs de fortes concentrations en métaux lourds (non détectés) susceptibles de se libérer ultérieurement.
Les MIOM ne sont pas inertes:
A partir d’expériences effectuées par le BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière) sur des plateformes de traitement de mâchefers, il est démontré que ceux-ci continuent à évoluer minéralogiquement et chimiquement (même à partir du moment où un mâchefer est reconnu Valorisable): pourquoi ?
Tout d’abord, soulignons la complexité des phases minérales composant les mâchefers : par exemple, pas moins de 30 sulfates différents ont été identifiés (Piantone et al, sous presse).
Les métaux lourds se trouvent dans une grande diversité de minéraux qui composent les mâchefers, on les trouve dans les oxydes (Cd, Ni, Cu, Cr, V, Zn, Pb, Sn), les silicates (Ni, Zn, Cr, Pb), les sulfates (Pb, Cr, Zn), les halogénures (Pb, Cu, Zn), les sulfures (Cu, Zn, Sn), etc...
Lorsqu’on stocke des mâchefers (même Valorisables), les eaux de pluie et de ruissellement qui les traversent se chargent plus ou moins en métaux lourds selon le moment de la percolation. Lorsqu’on analyse cette eau qui a percolé les mâchefers, les compositions de ces eaux sont extrêmement variables, et dépendent bien sûr de la teneur en métaux lourds du mâchefer, mais aussi et surtout des équilibres chimiques entre phases minérales et solutions drainantes, qui évoluent au cours du temps. En clair, les conditions physico-chimiques (température, ph…), inévitablement variables dans un stock de mâchefers traversés par l’eau de pluie et de ruissellement, vont plus ou moins favoriser d’une part des transformations de minéraux contenant des métaux lourds, les rendant plus ou moins instables, et d’autre part la dissolution des métaux lourds dans l’eau de percolation (Piantone et al, 2000, p.87).
Les études menées sur la stabilité chimique des MIOM montrent une grande complexité des phénomènes chimiques, que l’on ne cerne pas encore complètement. Une étude très récente (Piantone et al, sous presse) montre par exemple que « les sulfates et certains oxydes, qui sont extrêmement sensibles aux conditions environnementales, peuvent incorporer des métaux seulement temporairement ».
Il n’existe que très peu de retours d’expériences. Néanmoins, citons deux résultats significatifs.
- Lors d’expérimentations sur des plateformes d’essais simulant une chaussée où le MIOM est en couche de fondation, les concentrations relevées dans les eaux analysées ont dépassé les valeurs des seuils de potabilité pour les chlorures, les sulfates et le plomb (Piantone et al, 2000, p.74)..
- Sur un parc de stationnement avec utilisation de MIOM en couche de forme, on a fait l’observation étonnante suivante: alors qu’après 2 ans, l’influence de MIOM sur les eaux était modérée, on assiste après 12 ans, à un très fort relargage de zinc dans les eaux (Piantone et al, 2000, p.74)..
En conclusion, les mâchefers issus de l’incinération d’ordures ménagères, même s’ils sont déclarés Valorisables, ne sont pas inertes et peuvent être porteurs de métaux lourds susceptibles d’être entraînés à n’importe quel moment (dans 10, 100 ans ou plus) par les eaux de pluie et de ruissellement.
d) Conclusion:
Les MIOM étant des matériaux (1) très hétérogènes, (2) reconnus officiellement comme potentiellement dangereux, (3) caractérisés (V, M ou S) de manière non parfaitement fiable (par les seuls tests de lixiviation) et de manière inévitablement trop ponctuelle et (4) dont le potentiel polluant est variable et imprévisible au cours du temps, ils ne doivent être utilisés ou stockés que dans des conditions garantissant de manière définitive l’absence de risque de pollution vers le milieu naturel.

Références utilisées:
Damien A. Etude des caractéristiques intrinsèques de certains déchets des usines d‘incinération d‘ordures ménagères et de déchets industriels spéciaux, édité par le Ministère de l‘Ecologie et du développement durable, mars 1997 .
Pecqueur G., C. Crignon and B. Quénée. Behaviour of cement-treated MSWI bottom ash. Waste Management 21 (2001): 229-233
Piantone P., Blanc Ph. et BodénanF. Les mâchefers d’incinération d’ordures ménagère (MIOM). Etat de l’Art. BRGM/RP-50589-FR, et Ministère de l‘Ecologie et du développement durable, décembre 2000.
Piantone P., Bodénan F. and Chatelet-Snidaro L.: Mineralogical study of secondary mineral phases from weathered MSWI bottom ash: implications for the modelling and trapping of heavy metals. Applied geochemistry, sous presse.
Source : Gérard Miquel, Rapport Parlementaire 2000-2001, Sénat.
Les métaux lourds contenus dans les mâchefers d’incinération d’ordures ménagères pollueront inéluctablement d’une part l’eau des rivières sous-jacentes au site et d’autre part les terrains et pâturages alentour, par les poussières fines (inférieures à 80 microns : 0,08mm), présentes en très grande quantité dans les mâchefers. A titre d’exemple, nous n’évoquerons que le Plomb, le Cadmium et le Mercure.
Le Plomb . Il pénètre dans l’organisme de 3 manières différentes: inhalation, ingestion et voie cutanée. Il est distribué aux différents organes par le sang, principalement le foie, les reins, la rate, la moelle osseuse et surtout les os.
Les maladies qu’il provoque (saturnisme) sont des atteintes neurologiques, des encéphalopathie, des cancers… Les risques sont plus élevés chez les enfants(surtout de 1 à 3 ans). A exposition égale, l’organisme de l’enfant absorbe 50% de plomb ingéré, contre 5 à 7% chez l’adulte. Le système nerveux central des enfants est particulièrement sensible à la toxicité du plomb.
A titre d’exemple, une encéphalopathie aiguë convulsivante apparaît généralement lorsque la plombémie est de 1000 microg/l. Entre 500 et 700 microg/l, il apparaît une stagnation du développement intellectuel, une diminution de l’activité motrice, une irritabilité et une modification du comportement.
Le Cadmium . Les divers composés du Cadmium présentent des effets toxiques variables selon leur solubilité : par exemple, le chlorure de cadmium apparaît plus toxique que le sulfure de cadmium.
La toxicité du cadmium concerne le système respiratoire, gastro-intestinal et surtout les reins. Il est également classé comme cancérogène. L’absorption de cadmium par voie digestive, même en faible quantité, est suivie de nausées, vomissements et diarrhée. Ces troubles peuvent se compliquer en déshydratation grave de l’organisme.
Le Mercure . Sa toxicité est à présent clairement établie. Le mercure est extrêmement volatil, facilement soluble dans l’eau et les graisses. Il est donc très rapidement assimilé dans le corps humain. Une fois incorporé dans l’organisme, il peut se lier aux molécules constituant la cellule vivante, en modifiant leur structure ou transformant leurs fonctions.
Le mercure est un néphrotoxique, agissant sur les reins, et un neurotoxique, agissant sur le système nerveux.
Les symptômes peuvent être : altération et disparition de la vue, altération de la parole, de l’audition et de la marche, tremblements, troubles mentaux, ataxie (manque de coordination des gestes)
Sa toxicité varie selon sa forme physique. C’est sous la forme liquide qu’il est le moins toxique, car il quitte assez rapidement le corps par les voies naturelles. En revanche, sous forme vapeur, il est inhalé et se retrouve dans les poumons et le sang. Il est alors transporté notamment dans le cerveau. Sous forme ionisée, il pénètre dans le corps par voie cutanée ou respiratoire. Sa concentration s’opère alors dans le foie et les reins. Enfin, il peut se trouver en élément contaminant dans un organisme vivant. Il va alors faire partie de la chaîne alimentaire. Le phénomène de bioaccumulation ou bioamplification le rend alors particulièrement dangereux, car sa concentration va augmenter graduellement dans l’organisme des êtres vivants en fin de chaîne, comme l’homme.